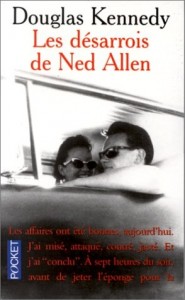 La première lecture de ce challenge concernait un ouvrage peu connu de Kennedy, Les désarrois de Ned Allen (1998, traduit en 1999 en français).
La première lecture de ce challenge concernait un ouvrage peu connu de Kennedy, Les désarrois de Ned Allen (1998, traduit en 1999 en français).
Le héros éponyme se trouve propulsé d’une situation très enviable de commercial new-yorkais, au train de vie plus que confortable, à celle de chômeur, mis au ban de sa profession (il a frappé son employeur) et abandonné par sa femme. Grâce à une vieille connaissance, il parvient néanmoins à sortir la tête de l’eau, mais c’est pour mieux se jeter dans les ennuis.
Ce premier roman m’a laissée perplexe car il manque d’unité, pour l’intrigue et a fortiori pour le style. La dernière partie du récit ne manque pas de rappeler les œuvres de Grisham, en particulier La Firme, qui a été adapté pour le cinéma. C’est une impression de littérature de gare qui dominait au sortir de cette lecture. C’est pourquoi je me suis lancée dans une seconde lecture du même auteur, plus consensuelle et surtout beaucoup plus relayée par les médias, La femme du Ve.
Le héros, Harry Ricks, paraît dans un premier temps moins antipathique que Ned Allen et le décor parisien ne manque pas de charme, en particulier lorsqu’il est familier. Cependant, on a le sentiment que Kennedy s’est empêtré dans son intrigue et qu’il lui a fallu trouver une porte de sortie à tout prix, au point que l’intervention du surnaturel arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. L’intrigue est bien ancrée dans une réalité peinte avec beaucoup de précision, et d’un seul coup tout bascule. Cela manque encore, me semble-t-il, de cohérence.
De ces deux lectures, plusieurs éléments ressortent. On peut tout d’abord reconnaître à Douglas Kennedy la qualité de savoir dépeindre à merveille des personnages englués dans les ennuis. C’est là que son style s’exprime le mieux, devient plus clair. Dans les deux romans, ce sont les passages où Ned Allen et Harry Ricks sont dans une panade incommensurable qui sont les plus délectables. L’auteur réussit à les rendre sympathiques, même s’il est parfois tentant de les secouer quand ils se morfondent. A l’inverse, quand l’auteur se lance dans la description de milieux aisés, new-yorkais ou parisiens, son style devient lourd, ampoulé, et le lecteur s’ennuie.
Enfin, ce qui m’a le plus gênée, c’est le manque de cohérence des romans. Ils semblent composés d’idées éparses, mises bout à bout, avec une logique parfois branlante, un peu comme un patchwork. Les intrigues paraissent constituées de textes écrits presque indépendamment, et assemblées pour former un roman. Pour faire le liant, rien de tel que des personnages tombés du ciel, qui jouent alternativement le rôle de sauveurs ou de bourreaux.
Je doute par conséquent de replonger de sitôt dans les œuvres de Douglas Kennedy, qui permettent de passer le temps, mais sans grand plaisir. De la littérature de gare, ou de plage.