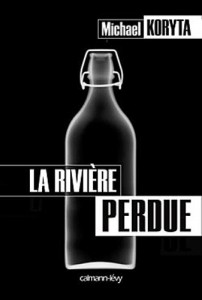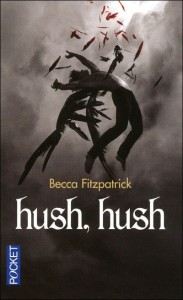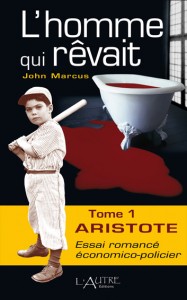 » Vous allez adorer John Marcus ! «
» Vous allez adorer John Marcus ! «
Certaines maisons d’édition de moindre envergure, à l’image de L’Autre Editions (dont l’efficacité mérite d’être saluée), prouvent chaque jour que les auteurs sont souvent mieux considérés que chez les plus grandes. Présenté comme le précurseur de « l’essai romancé économico-policier », appuyé par des encouragements qui ne tarissent pas d’éloges (« Lire John Marcus est un acte citoyen du monde« … ah oui, quand même) et armé d’un titre idéal… L’homme qui rêvait met en condition son lecteur dès la 4e de couverture, et le laisse en droit d’attendre beaucoup. Une campagne marketing intéressante, mais peut-être trop osée.
S’il est un débat à faire s’arracher les cheveux de nos Immortels, outre les mauvaises formulations orthographiques, c’est celui du mélange des genres. Qu’est-ce qu’un roman, une nouvelle, un essai, un pamphlet ? Car il n’est pas rare qu’un auteur laisse librement vaquer ses préoccupations politiques ou ses idéaux dans une oeuvre de fiction, au point d’être légitimement en droit de se demander s’il ne s’agit pas davantage d’un essai que d’un roman, par exemple. John Marcus a fait le pari qu’il était possible d’associer librement les genres, l’assume et le revendique. Mais lorsque le tragique de nos quotidiens intervient dans la fiction, que reste-t-il au lecteur pour s’évader de la réalité ? Car L’homme qui rêvait n’est pas du Zola : il ne choisit pas d’encrer des comportements et des injustices dans une existence fictive mais, au contraire, il livre des réalités économiques et sociales sans prendre la peine de les rattacher au récit.
En effet, on peut s’attendre à ce qu’un roman, même couplé à l’essai, construise son intrigue au rythme des problématiques explicitées par l’auteur. Or, ici, il n’en est rien. Aucun des personnages (Delajoie, Ricky, Kowiak…) n’a d’incidence directe sur le récit. A la manière de pantins désarticulés, ils ne servent qu’à agiter un décor vide de sens. L’auteur aborde tant de soucis économiques, de drames politiques et de mythes d’un autre âge qu’il oublie que donner une âme à ses protagonistes est la première règle de la fiction ; et ce n’est pas l’humour un peu potache, simplet, voire provincial (les surnoms, la tomme d’Aubrac, les blagues-clichés entre policiers, le public hilare à chacune des interventions du sénateur Aristote) qui permet d’insuffler la vie.
» Loin d’être […] un pamphlet manichéen «
Paradoxalement, L’homme qui rêvait fait de l’économie son cheval de bataille et prend largement le pas sur le reste du livre. En prétendant à l’écriture d’un roman policier, l’auteur se donne surtout la difficile tâche d’expliquer le monde dans lequel nous vivons, ses ressorts et ses crises d’une manière suffisamment simple pour qu’elle soit compris par tous. Et il semble désirer ce discours si limpide et compréhensible qu’il est omniprésent, comme si le programme présidentiel du sénateur Aristote résumait l’homme ; dont l’assassinat, qui fait pourtant office d’élément perturbateur, n’est quasiment pas abordé… La moitié du livre est en effet consacrée aux réformes économiques et sociales proposées par le personnage. Or, on se contente de livrer la plupart des informations sous la forme d’une émission TV de débat en la présence d’intellectuels et d’une présentatrice dénommée Madame… Rabot. Il m’aurait pourtant semblé que les chaînes publiques proposaient suffisamment ce genre de programmes pour qu’on ait pas à les supporter jusque dans la fiction ?
Quant aux éléments de réflexion apportés par l’auteur, ils demeurent très scolaires. Le « laisser faire/laisser passer », la Main Invisible, le conflit entre néo-classique et keynésiens, l’aberration des crédits à la consommation… sont tout simplement au programme du lycée. La légende du roi Midas, la sociologie du travail, le totalitarisme rouge, les tribulations du FMI (demandez donc au peuple grec !), « 400 personnes s’approprient 50% des revenus annuels de l’humanité« … sont des faits également rabâchés durant la scolarité ou dans les médias, quotidiennement. N’aurait-il pas été plus avisé et moins « bateau » de mentionner la métaphore du « concours de beauté », l’irresponsabilité des agences de notation lors de la crise des subprimes ; ou de ne pas faire l’impasse sur un terme comme « thésaurisation » (incontournable chez Keynes, à la manière de la « loi psychologique fondamentale »), certes abordé mais jamais défini.
La beauté d’un concept, dans la fiction, tient justement à ce que le lecteur l’intègre naturellement, de lui-même, sans s’en rendre compte. Mais L’homme qui rêvait veut forcer cette assimilation car, même si la plus grande partie des informations fournies par John Marcus devraient incontestablement faire partie de la culture générale de chacun, l’auteur s’acharne à utiliser des raccourcis narratifs enclins à la facilité. Encore une fois, cette émission de TV qui occupe plus de 100 pages, entrecoupée d’éléments narratifs inconsistants, accumule des citations et des références historiques qui n’en finissent pas. Pire, Aristote seul (sorte de mi-Mélanchon/mi-Hessel) expose ses arguments alors que les autres personnages ne servent qu’à le relancer, à commettre des approximations sur lesquelles rebondir, et qui jamais ne permettent la concurrence des opinions. Dans une autre scène, le personnage de La Boule revient d’un voyage en avion (transport dont il a une peur bleue), terriblement fatigué et avec une affaire de meurtre sur les bras : il se contente alors de faire l’énième récapitulatif d’épisodes historiques relatifs à chaque nom de rue qu’il emprunte et à conclure « la violence des faits […] lui avait fait découvrir l’attachement viscéral liant la classe ouvrière aux acquis sociaux ». Rien que ça ?
Conclusion
Bien que mettant en scène des policiers, on reprochera avant tout au livre de ne pas détailler cette dimension ; pourtant susceptible d’intéresser les lecteurs réguliers de polars et autres romans noirs. En proposant un projet avec la volonté « de sortir des rangs », l’enjeu est à double-tranchant : rondement mené, il passionne (surtout lorsqu’il s’agit de faire la critique du modèle dominant) ; et à l’inverse, mal équilibré, l’oeuvre devient un fardeau pour le lecteur. Malheureusement, il me semble que L’homme qui rêvait, malgré certaines remarques fines et intelligentes, se perd dans les banalités économiques, en fait souvent trop (« Nous ne devions rien attendre de l’Histoire parce que, en réalité, l’Histoire attendait tout de nous« , par exemple) et oublie que la notion de « romancé » nécessite avant tout de fournir au lecteur un univers solide auquel il s’attachera.