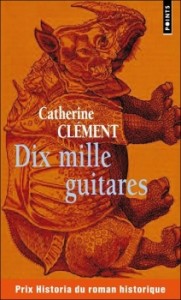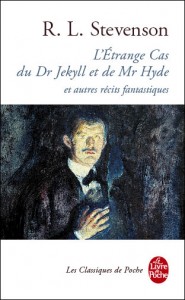ÆRKΔOS – Le sésame vers un autre monde est l’ouvrage regroupant les trois tomes : T1 Les frères de la ville morte, T2 l’héritier des Akhangaar, T3 Les faiseurs de mondes.

Résumé :
Les livres ont une puissance insoupçonnable. C’est ce que n’aurait jamais dû découvrir Oonaa, jeune vestale recluse dans la Citadelle de Maahsandor. Rien n’était censé venir bouleverser l’existence de la jeune fille, soumise aux règles de l’Ordre vunique. Pourtant, dès lors qu’elle entre en contact avec un groupe de dissidents, Oonaa n’hésite pas à se mettre en péril. Elle apprend à discuter tes vérités qu’on lui a enseignées, à expérimenter le doute, la trahison. Elle comprend aussi que les livres sont des passerelles entre les hommes et, plus étonnant encore, entre les mondes… … Telle est l’histoire dont Ferdinand lit le récit dans un intrigant manuscrit trouvé chez son oncle. A sa grande stupéfaction, la fiction rattrape bientôt la réalité : son chemin et celui de Oonna vont inexorablement se croiser…
Mon avis :
Tout d’abord soyez assurés qu’en lisant ceci vous n’aurez aucun éléments qui vous dévoilent la suite ou la fin de l’aventure. Comme je ne veux pas vous gâcher votre lecture je resterai suffisamment vague pour ne pas vous en dévoiler plus que nécessaire pour vous « accrocher ».
Dès le départ nous sommes intrigués par ce livre que découvre Ferdinand : un livre en apparence banale, avec une couverture en cuir un peu usée. Seulement voilà : lorsque l’adolescent ouvre le livre il se trouve face, non pas à des lignes dactylographiées mais à une fine écriture manuscrite assez serrée, qui s’étend sur seulement quelques pages. Le héros se plonge alors dans sa lecture et découvre l’histoire d’Oona.
Puis au moment où nous avons totalement oublié Ferdinand : l’histoire s’arrête.
L’adolescent a fini de lire les pages manuscrites.
Quelques instants après : l’écriture reprend sous ses yeux : le livre s’écrit tout seul…
Nous sommes donc tout de suite interpellé par ce mystère, et en même temps que nous suivons les aventures de Oona qui se retrouve malgré elle, plongée dans une rébellion étouffée par le pouvoir draconien religieux en place. Mais elle ne tarde pas à se rendre compte que ces soit-disants hérétiques ont raison, et les événements la poussent à changer radicalement de perspective d’avenir.
Le premier tome est riche en rebondissements, et pose le contexte dans lequel le monde des Terres Choisies se trouve. Son histoire est captivante et dessine la trame principale mise en scène dans les tomes suivants.
Le deuxième tome est un peu moins animé, et surtout axée sur la recherche d’un élément essentiel au bon déroulement de la quête. C’est une sorte d’enquête policière menée dans notre monde par Ferdinand et les autres protagonistes.
Enfin le troisième tome marque la reprise de l’action pure et dure, rebondissements, cascades, les héros se dépassent et font tout pour … non je ne peux pas vous le dévoiler je ne veux pas vous gâcher votre lecture.
Dans l’ensemble cette trilogie est une mine d’or de pépites livresques. On y trouve de superbes métaphores de la lecture en elle-même.
Par ailleurs la mise en abyme de la couverture (sur la couverture du livre regroupant les trois tomes est représenté : un livre, on a donc là une mise en abyme du livre-objet) illustre la mise en abyme de la lecture qui est un thème abordé tout au long de l’histoire (ne serait-ce que par la trame de départ : un héros lit l’histoire d’une autre héroïne).
Tout est très bien imaginé et original : l’étrange don de Oona, l’histoire de Soqhar et Aqhar, et surtout : la relation entre les livres et les mondes.
Le troisième est certainement le plus intéressant au niveau réflexions sur notre façon de voir les choses et sur nos croyances, de plus on comprend enfin les liens entre tous les personnages et l’origine de l’histoire en elle-même.
En résumé ce livre est un cocktail de pépites (que ce soit histoire des personnages ou personnages eux-mêmes). On est tenu en haleine jusqu’au bout, jusqu’à la dernière page, jusqu’à la dernière phrase, et jusqu’au dernier mot : impossible de deviner la fin avant le dernier chapitre. Un pur délice.