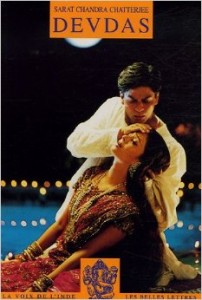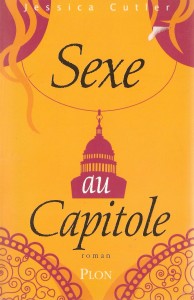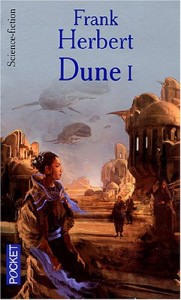« Je n’ai aucune idée de ce que Parvoti est devenue maintenant à la suite de tant d’années. Je ne cherche pas à le savoir non plus. Mais c’est pour Devdas que j’éprouve un profond chagrin. Après avoir lu l’histoire tragique de sa vie, vous éprouverez sans doute le même sentiment que moi. Néanmoins, si jamais vous rencontrez un malheureux, un débauché et un pécheur comme Devdas, alors priez pour son âme. Priez pour que, quoi qu’il advienne, personne ne meure de la même façon pitoyable que Devdas. La mort n’épargne personne. Mais qu’à cette dernière heure, le front du mort reçoive le toucher de doigts affectueux, que la flamme de sa vie s’éteigne sous le regard d’un visage empli d’affection et de compassion, qu’il voie au moins une larme dans les yeux d’un être humain. Ce serait pour lui un bonheur suffisant au moment de son départ pour l’autre monde. »
Le narrateur conclut ainsi l’histoire tragique de Devdas, le personnage central du roman. Publié en 1917, ce roman raconte l’une des plus fascinantes histoires d’amour de notre époque. Devdas captive encore aujourd’hui aussi bien les lecteurs que les cinéphiles, ce qui témoigne de sa classe et de son caractère. Un des chefs-d’Œuvre de Sarat Chandra Chatterjee (1876-1938), considéré au Bengale comme un Maître conteur (Katha-shilpi), Devdas révèle un trésor de la littérature romantique indienne.
Mon avis
On dit de Devdas qu’il serait à l’Inde ce que Roméo et Juliette est à l’Angleterre… Eh oui, encore une chouette histoire d’amour impossible qui, bien entendu, se termine terriblement mal. Mais ça, la quatrième de couverture n’en fait pas mystère… Un grand classique indien du genre, donc, qui nous relate les amours contrariées du héros, Devdas, et sa lente déchéance dans l’Inde du début du XXème siècle.
Le roman est très court, sans doute trop à mon goût puisqu’il m’a donné la triste impression qu’il ne s’y passait pas grand-chose, et certainement pas une grande histoire d’amour ! Ce que j’y ai vu, moi, c’est un homme et une femme se cherchant sans jamais se trouver, par faiblesse, par respect des conventions, par fierté, par non-dits… Compte tenu du grand succès de ce livre (Chatterjee fut le premier auteur indien à vivre de sa plume) et ses multiples adaptations cinématographiques, il semblerait que je sois tout simplement hermétique au chef-d’oeuvre, auquel cas il est préférable que vous tentiez votre chance sans tenir compte de mon avis !
Au-delà du style assez vieillot qui m’a déplu, la traduction française reprenant sans doute le bengali de l’époque, les personnages ne m’ont pas vraiment émue et je n’ai finalement réussi à m’intéresser à l’histoire que sur la fin… Alors bien sûr, d’un point de vue sociologique, le roman reste intéressant pour sa description de l’univers indien, où le respect de l’ordre figé des castes et du milieu social prime sur les sentiments, ainsi que pour son opposition entre monde rural et monde urbain, lieu de débauche et de corruption où Devdas rencontrera la courtisane Chandramukhi.
En résumé, à lire si vous souhaitez vraiment parfaire votre connaissance de la littérature indienne ou lire un texte qui reste considéré comme l’un des plus grands ouvrages indiens. Autrement, vous pouvez vous contenter du film !