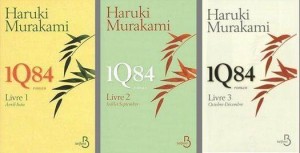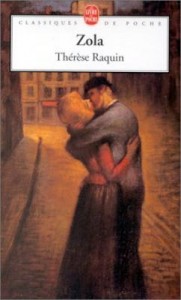 Titre : Thérèse Raquin
Titre : Thérèse Raquin
Auteur : Emile Zola
Editions : Le livre de poche
Collection : Le classique de poche
Pages : 319
Résumé :
Thérèse Raquin est la fille d’une Algérienne et d’un capitaine français, Degans, posté en Algérie. Thérèse a deux ans ; son père la confie à sa soeur, Madame Raquin, qui habite en métropole. Elle a un fils, Camille, de santé fragile. Thérèse partage l’enfance et l’adolescence de Camille. Lorsque Thérèse a 18 ans, Madame Raquin marie les deux cousins. Camille souhaite aller vivre à Paris et travailler dans une grande administration. Madame Raquin trouve une boutique et un appartement au passage du Pont Neuf. Les femmes y ouvrent une mercerie tandis que Camille trouve un emploi dans l’administration du chemin de fer d’Orléans. Pour Thérèse commencent trois années de vie monotone, ponctuées tous les jeudis soir par la visite des mêmes invités : le vieux Michaud, commissaire de police retraité et ami de Madame Raquin, son fils Olivier, également dans la police, sa femme Suzanne et Grivet, collègue de Camille : Ils prennent le thé en jouant aux dominos. Thérèse déteste ces soirées.
Mon avis :
J’avais déjà lu cette oeuvre il y a 8 ans mais je ne m’en rappelais absolument pas. Je pensais me rappeler d’une image mais je ne l’ai pas retrouvé dans cette relecture. Je pense que j’ai confondu avec une scène d’Une vie de Maupassant. Rien à voir! Je ne sais même pas comment j’ai pu mélanger les deux histoires. Le seul aspect commun est le fait qu’il y a un crime commis.
J’adore Zola, je l’aime beaucoup, c’est mon chouchou de la littérature classique, mais avec celui-là, j’ai eu du mal à accrocher. C’est le roman de cet auteur le plus dur émotionnellement que j’ai lu. J’étais mal à l’aise. J’aime toujours autant son écriture mais finalement il n’y a presque que de la violence. Zola a réussi à me faire ressentir le mal-être des personnages. Ils sont horribles, pour moi ils méritaient d’être mal. Ils sont hantés par le fantôme de Camille et on ressent bien cette oppression. Ils le voient partout, il est partout. Ils méritaient pire que ce qu’il leur arrive à la fin.
D’ailleurs, je souhaite exprimer mon mécontentement au sujet des notes faites par la maison d’édition : pourquoi, parce que c’est un classique, les commentateurs se sont-ils permis de spoiler quatre fois l’histoire dans leurs notes? C’est la forme et non le fond qui compte dans un classique mais cela gâche tout de même la lecture.
Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle avec sa célèbre saga :
Ce que j’adore dans les Rougon-Macquart, c’est qu’il y a une histoire à côté, on suit les personnages d’un roman à un autre. Je m’attache. Mais ici, je ne me suis attachée à personne même à Madame Raquin, que j’aurais dû prendre en pitié, ne m’a pas tellement émue. Elle m’a, certes, un peu touchée à la mort de son fils et quand elle a su le crime mais pas non plus à en verser des larmes (pourtant je suis très émotive).
J’avais hâte de redécouvrir ce roman, j’ai été un peu déçue mais ce n’était pas non plus une plaie de le lire. Je préfère cet auteur dans les Rougon-Macquart.