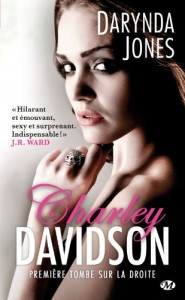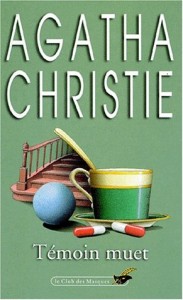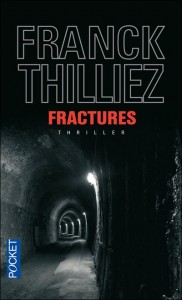Synopsis :
Charley Davidson est détective privée et faucheuse. Son boulot consiste à convaincre les morts « d’aller vers la lumière ». Mais ce n’est pas toujours si simple : parfois Charley doit les aider à accomplir quelque chose avant qu’ils acceptent de s’en aller, comme retrouver l’assassin de ces trois avocats. Ce qui ne serait pas un problème si Charley ne passait pas son temps à faire des rêves érotiques provoqués par une entité qui la suit depuis toujours… Or, il se pourrait que l’homme de ses rêves ne soit pas mort. Il pourrait même être tout à fait autre chose…
J’ai Adoré !!
Charley, diminutif de Charlotte, Davidson est détective privée et aussi, LA Faucheuse.
Elle doit guider les morts vers La Lumière et les faire passer de l’autre côté. A ceux qui pensent tomber dans Ghost Whisperer, pas vraiment.. Effectivement, elle aide parfois les fantômes à accomplir une dernière volonté. Mais tout comme chaque livre de vampires n’est pas un remake de l’œuvre de Bram Stoker, laissons à l’auteur son originalité. Les vampires boivent du sang, les goules mangent de la chair, les fantômes doivent suivre La Lumière.
De part son métier et étant la fille et nièce de flics, ce livre est sur fond d’enquête policière, ce que j’ai beaucoup apprécié, étant amatrice du genre.
L’héroïne est sexy, sarcastique, modeste, pleine de ressources, et se fait régulièrement « botter les fesses », mais elle seule peut porter un tel nom la tête haute : Charley Davidson ! Elle n’est ni invulnérable ni trop fragile, elle a ses défauts, peut-être est-ce tout cela qui fait qu’elle est attachante…
Nous trouverons des personnages secondaires intéressants, avec tous des bons comme des mauvais côtés, ici pas de Bien contre le Mal, mais plus de nuances… Nous avons donc des fantômes, des policiers, dont son oncle qu’elle aide à résoudre des meurtres, une bonne copine Cookie et sa fille, un collègue sceptique, Le Grand Méchant et un type mystérieux et sexy qui hante les rêves torrides de l’héroïne.
Ce premier tome n’est ni bourré d’action comme un Kate Daniels, ni bourré de romance comme un Psi-Changeling, ni plein de sexe comme un des derniers Anita Blake, mais un savoureux mélange à juste dose de tout ça avec un humour persistant.
J’ai toutefois trouvé le côté paranormal (outre les fantômes) un peu plat vers le milieu, mais c’était pour mieux apprécier les rebondissements et révélations vers la fin du livre. Et grâce à la plume de Darynda Jones, fluide et agréable, vous n’aurez qu’une hâte : lire le second tome.
Le petit plus, ce sont les citations en début de chapitre, elles ne viennent pas de personnes connues ni d’auteurs célèbres, mais sont un clin d’œil de l’héroïne : humour et sarcasme. Vous aurez le sourire sans vous en rendre compte !! »
C’est ma première critique, faite pour le challenge Livra’deux avec realisaude.
Quelques soient les critiques, je suis preneuse…^^