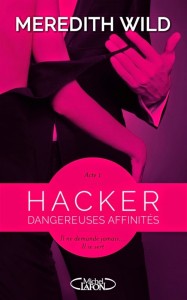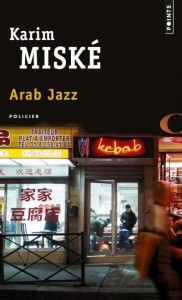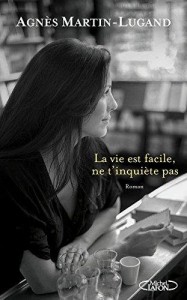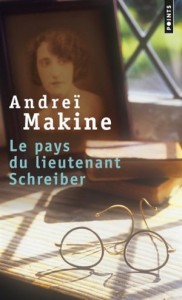Erica Hathaway n’a pas de temps à consacrer aux hommes. À peine sortie d’Harvard, elle compte bien réussir sa carrière professionnelle grâce à son site Internet dédié à la mode. Très déterminée, elle présente son projet devant plusieurs investisseurs. Mais Erica a tout prévu sauf un détail : Blake Landon. Millionnaire, arrogant, sublime. Après une réunion électrique et mouvementée, Blake ne lui cache pas à quel point il la veut. Tout de suite. Et Blake n’a pas l’habitude de demander, il se sert… Entre ses ambitions professionnelles et son désir inavouable pour cet homme qui peut mettre son avenir en danger, Erica saura-t-elle faire le bon choix? D’autant que l’un et l’autre cachent des secrets sur leur passé qui pourraient rendre leurs rapports explosifs. Ou carrément torrides… OSERA-T-ELLE S’ABANDONNER ?
Mon Avis :
Tout d’abord je voudrais remercier Livraddict et les éditions Michel Lafon pour m’avoir permit de lire ce livre en partenariat. C’est parti !
Une romance érotique dans l’univers cybernétique ? Voilà peut être de quoi se démarquer dans un genre en plein boum qui commence à sérieusement s’épuiser…Malheureusement ce ne sera pas suffisant.
Parlons de nos deux personnages principaux pour commencer. On nous présente Erica comme une jeune diplômée sérieuse, belle, avec la tête sur les épaules et prête à sacrifier sa vie personnelle pour réussir. Blake lui est le stéréotype même de ce genre de roman : jeune, beau à en tomber, millionnaire, sure de lui, un brin arrogant…et comme souvent, avec des tendances à la domination très prononcées. Seul point original, c’est un ancien geek qui s’est taillé une solide réputation de hacker et a construit sa fortune grâce à ses compétences pour le moins particulières.
Quand j’ai découvert le personnage d’Erica je me suis dis : chouette ! Enfin un personnage féminin solide ( chose rare dans ce genre de roman…) ! Et au final, je trouve que son personnage est mal géré. Ces actes et ces pensées sont parfois aux antipodes. Elle se promet de ne pas céder à ce Blake Landon, cet homme certes plus qu’attirant, mais qui s’est montré odieux et a presque fait capoter son projet professionnel et sa carrière. Elle veut donner l’image d’une femme forte, nous répète sans cesse dans les premières pages que non est la réponse définitive et… elle se retrouve dans son lit quelques pages plus tard. Toute la crédibilité de ses traits de caractères s’envolent. En réalité elle n’est ni plus ni moins qu’une « héroïne » lambda dans se genre de roman : elle n’a pas vraiment de volonté, dit amen a tout ce que son homme peut dire, un caractère plat… Parfois elle fait mine de se rebeller, de vouloir placer une opinion, mais ses petites tentatives sont si peu crédibles qu’on connaît déjà la suite et le personnage perd tout son intérêt pour se tourner en ridicule. Vouloir créer un personnage de femme forte et indépendante ce n’est pas juste écrire « elle est comme ça », c’est le montrer, et la faire agir en conséquence.
Blake lui est comme je l’ai dis le stéréotype même de l’homme dans ce genre de roman : il persuadé que sur son front est écrit « king of the world » . Beau, intelligent, un charme à toute épreuve, rusé, riche, respecté… le seul point qui aurait pu faire de lui un personnage un peu plus intéressant, qui se démarquerait, est son passé en tant que hacker, mais celui-ci est si peu et si mal exploité qu’au final ça ne reste qu’un détail et fait de lui un autre personnage lambda.
La romance avance comme dans tout les romans de se genre : je t’aime moi non plus, avec une bonne dose de sexe qui résout tout. Les autres personnages sont quasi inexistants tant ils sont peu intéressants. Le style est simple, ça se lit très vite.
Mais au final le livre est plat: tout ce qui est annexe à la romance n’est pas assez mis en valeur. On nous a tellement gavé de ces romances érotiques ces derniers temps que j’ai l’impression de toujours lire la même chose. A peine le premier chapitre passé je sais déjà comment l’histoire va évoluer et se terminer, puisqu’elles suivent toutes le même schéma. Peu trouvent donc grâce à mes yeux et « dangereuses affinités » n’en fait définitivement pas parti malgré le petit potentiel qu’il y aurait pu avoir derrière. La suite ? Je ne la lirais pas, à quoi bon, la suite je la connais déjà.